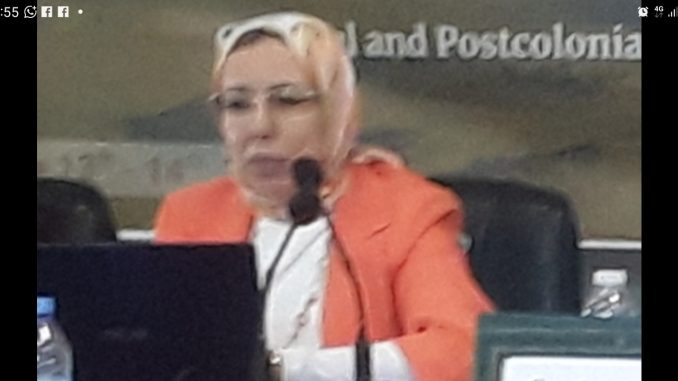
Oujda – 17 juin 2025
Dans le cadre du troisième colloque international sur la littérature, les arts plastiques, le théâtre et le cinéma miniers, organisé les 13 et 14 juin 2025 par l’équipe d’études culturelles du CERHSO en collaboration avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLHO) de l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda, le Dr. Rachida SAIDI, professeure de littérature française, a présenté une intervention intitulée « La dame au grand chapeau de Florence Trystram : la mémoire coloniale de la ville de Boubker ».
Cette contribution, inscrite dans le thème du colloque – Discours coloniaux et postcoloniaux dans la production littéraire et artistique liée à l’exploitation minière –, propose une analyse pénétrante de l’œuvre de Florence Trystram, publiée en 1996, qui mêle mémoire personnelle, histoire coloniale et réflexion sur l’exploitation minière au Maroc.
Ancré dans la ville de Boubker, près d’Oujda, et intimement lié à la mine de Zellidja, ce récit dépasse le cadre biographique pour interroger les dynamiques complexes de la colonisation, de l’extractivisme et de la mémoire collective.
Cet article s’appuie sur l’analyse du Dr. Saidi, pour explorer les multiples facettes de cette œuvre, entre idéalisation et critique, dans une perspective à la fois littéraire et historique.
Une mine au cœur de l’imaginaire littéraire
Comme le souligne le Dr. Saidi dans son intervention, la mine est un « carrefour anthropologique », un espace où se croisent récits de labeur, de solidarité, mais aussi de souffrance et d’exploitation.
Dans la littérature, elle incarne un chronotope, selon l’expression de Mikhaïl Bakhtine, où se condensent des questionnements sociaux, culturels et environnementaux.
Florence Trystram, née à Boubker, où son père était directeur adjoint de la mine de Zellidja, s’inscrit dans cette tradition tout en adoptant une perspective singulière. Historienne et romancière, elle conjugue une rigueur documentaire – chiffres, rapports géologiques, archives – à un talent narratif qui transforme l’histoire de la mine en une aventure humaine, presque romanesque.
Ce mélange de précision factuelle et d’élan romanesque confère au récit une richesse particulière, où l’histoire individuelle de Domenica Walter-Guillaume, épouse de Jean Walter, s’entrelace avec celle de Boubker, un village transformé en « oasis extraordinaire » par l’ambition démesurée de son mari.
Le titre, La dame au grand chapeau, intrigue dès le départ. Qui est cette femme ? Quelle est sa place dans l’univers minier, traditionnellement masculin ?
Domenica incarne une figure complexe : à la fois spectatrice et actrice d’un projet colonial, elle symbolise l’élite parisienne des années folles, avide de luxe et de pouvoir. Son rapport à la mine, marqué par une cupidité calculatrice, contraste avec l’image héroïque de Jean Walter, architecte visionnaire devenu magnat minier.
Trystram, en dédiant son livre aux habitants de Boubker, semble vouloir réconcilier son regard d’enfant – celui de la « petite fille aux tresses sages et au regard insolent » – avec une réflexion critique sur les implications de cette aventure industrielle.
Boubker : de l’eldorado au mirage colonial
Le récit retrace l’ascension fulgurante de Jean Walter, dont la fortune, colossale à sa mort, repose sur « quelques arpents de désert » dans l’Atlas marocain. Dès son enfance, ce passionné de roches et de voyages manifeste une détermination hors norme, pédalant à travers l’Europe pour nourrir sa curiosité.
Architecte talentueux, il construit hôpitaux et immeubles, mais c’est au Maroc, en 1925, qu’il trouve sa véritable vocation. Une dette de 75 000 francs, réglée par la cession d’un droit minier sur un puits romain, marqué le début de l’épopée de Zellidja.
Malgré les déboires – crises économiques, guerres, désillusions initiales – Walter transforme Boubker en un modèle d’urbanisme colonial, avec des quartiers européens et arabes, des écoles, des magasins et des plantations. En 1952, la ville devient, selon Trystram, un « paradis terrestre », une vitrine de la mission civilisatrice française.
Mais cette vision idéalisée, portée par un patriotisme colonial, cache une réalité plus sombre. Comme le souligne le Dr. Saidi, l’exploitation de Zellidja illustre les paradoxes de la France coloniale : un humanisme affiché, incarné par les cités ouvrières et les infrastructures modernes, dissimule un « extractivisme prédateur ».
La mine, vidée en quelques décennies pour maximiser les profits, devient après l’indépendance du Maroc une « coquille vide ». Cette approche, qui privilégie l’enrichissement rapide au détriment d’une gestion durable, reflète la logique capitaliste et coloniale de l’époque.
Jean Walter, malgré son image de bâtisseur visionnaire, incarne cet impérialisme dur, où la terre marocaine est exploitée sans égard pour ses habitants ou son avenir.
Une absence éloquente : les autochtones de Boubker
L’un des aspects les plus troublants du récit, mis en lumière par le Dr. Saidi lors du colloque, est l’effacement des autochtones. Dans La dame au grand chapeau, les habitants originaires de Boubker sont relégués à l’arrière-plan, réduits à une main-d’œuvre difficile à « stabiliser ». Trystram note la réticence des nomades à travailler dans la mine, un espace perçu comme hostile, où « les démons sont rois ».
Les employeurs, pour surmonter cette résistance, recourent à des tests psychotechniques, outils bureaucratiques et racistes qui, comme l’analyse Michel Foucault dans ses travaux sur le savoir et le pouvoir, servent à contrôler et à discipliner les populations colonisées.
Edward Said, dans L’Orientalisme, avait déjà dénoncé cette vision réductrice de l’« Orient », où les autochtones sont dépossédés de leur voix et de leur histoire.
Cette absence des Marocains dans le récit reflète une vision a-historique, où le colonisateur, tel un « fantôme » selon l’expression d’Edgar Morin, hante la terre sans la comprendre. Les nomades, attachés à une relation harmonieuse avec leur environnement, perçoivent la terre comme une « mère nourricière », incompatible avec l’exploitation minière.
Cette fracture culturelle, ignorée par les prospecteurs, met en lumière l’arrogance d’un projet colonial qui, sous couverture de progrès, dépossède et marginalise.
Une œuvre ambivalente : entre humanisme et critique anticoloniale
La dame au grand chapeau est une œuvre profondément ambivalente, comme l’a brillamment démontré le Dr. Saidi dans son intervention. D’un côté, Florence Trystram célèbre l’épopée de Zellidja, portée par l’énergie et l’ambition de Jean Walter.
De l’autre, elle invite à une réflexion critique sur les coûts humains et environnementaux de cette entreprise. Cette ambivalence s’inscrit pleinement dans le thème du colloque, qui explore les discours coloniaux et postcoloniaux dans les productions artistiques liées à l’exploitation minière.
Le Dr. Saidi qualifie cet ouvrage d’« humanisme anticolonialiste », une démarche qui, sans tomber dans une vision manichéenne, reconnaît les progrès du Maroc postcolonial tout en interrogeant le legs colonial.
Ce retour à la mémoire de Boubker, ville natale de l’autrice, est un acte de devoir, mais aussi une invitation à repenser les défis actuels des villes minières, souvent laissées à l’abandon.
En conclusion,
La dame au grand chapeau est une œuvre riche et complexe, qui transcende le simple récit biographique pour devenir un miroir des tensions de l’ère coloniale. À travers le destin de Domenica et de Jean Walter, Florence Trystram explore les promesses et les trahisons de l’exploitation minière, entre rêve d’eldorado et réalité d’un pillage déguisé.
Cette intervention du Dr. Rachida Saidi au colloque de l’UMP d’Oujda nous rappelle que la littérature, en interrogeant le passé, peut éclairer les chemins d’un avenir plus juste, où les voix des oubliés – celles des autochtones, des exploités – trouveraient enfin leur place

Soyez le premier à commenter